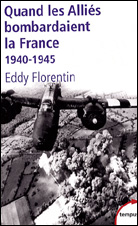Que le lecteur me soit indulgent si je débute cette recension par une histoire personnelle qui me tient à cœur.
Quand j’étais enfant, je demandais toujours à ma grand-mère de me raconter la guerre comme d’autres réclamaient la lecture d’un conte. Née en 1911 dans un village ardennais, elle avait connu tous les conflits qui ont ponctué le siècle. Du premier, elle avait conservé une haine inextinguible des casques à pointe qui avaient brûlé sa maison, ruinant à jamais sa famille et son commerce de maréchalerie. Son père mourut en 1916 dans le fond d’une tranchée boueuse et sa mère fut emportée par la grippe espagnole en 1918. Cruelle fatalité dont elle porta le deuil jusqu’à son propre décès. Du second, elle m’en parla à l’âge adulte alors que je la questionnais sur sa vie sous l’occupation des Allemands. Elle passa rapidement sur l’épisode de l’exode forcé de mai 1940, la jetant avec tous les autres villageois sur les routes de Vendée, quatre marmots accrochés à ses jupons et un cinquième « dans la hotte », selon son expression. Épouse de cheminot, elle fut la première à réintégrer un village très peu meurtri par les bombardements. Elle préférait « mourir sous les bombes allemandes (bien qu’[elle avait] une trouille bleue des sirènes de Jéricho) plutôt que de manger deux jours de plus ces infâmes mogettes chez les ventres à choux » (sic).
Les soldats de la Wehrmacht avaient pris leurs quartiers dans les locaux de la gare et chaque jour, elle envoyait ses quatre enfants (dont le cadet à peine âgé de deux ans), chercher la pitance. Dès l’été 40, les Allemands, qui avaient reçu la consigne d’être bienveillants à l’égard des Français, remplissaient copieusement les gamelles des gamins tout fiers de ramener le repas familial. Les autres villageois revinrent de Vendée et prirent également l’habitude d’expédier leur progéniture au « rata ». À l’époque, les femmes se réunissaient sur le trottoir pour éplucher leurs légumes et taper la causette sur les potins de voisinage. Un jour qu’elle écossait les petits pois tout racontant l’histoire du comte de Monte-Cristo, un officier allemand l’apostropha et lui demanda si elle connaissait Alexandre Dumas qu’il appréciait beaucoup. Et les voilà partis tous les deux à deviser sur Zola, Flaubert, Maupassant et compagnie au milieu des autres femmes qui n’en revenaient pas d’entendre « la Camille des Tchourlis» parler de gens dont elles ignoraient jusqu’alors l’existence. « Tu te rends compte, Ninou, me dit-elle un soir, il connaissait même Rabelais. Et quand je lui ai demandé si la guerre allait bientôt cesser, il m’a répondu : « Ach, Mâdâme ! Pour nous, très difficile passer le tunnel. »
J’en ai déduit que cette conversation avait lieu en pleine bataille d’Angleterre. Plus tard, écrivant moi-même des articles historiques, je lui ai posé la question qui fâchait : le maréchal Pétain. Elle leva le menton, me toisa d’un regard glacial et me répondit sèchement : « Le maréchal, c’était le maréchal et je ne dirai rien ! ». Puis, elle m’annonça que mon grand-père et ses copains du chemin de fer étaient à la fois résistants et pétainistes. J’étais ainsi fixée. Par contre, quelques piques bien amenées me laissèrent à penser que les Alliés n’étaient pas vraiment en odeur de sainteté. Pourquoi ? Je l’ai longtemps ignoré ! Ma génération avait reçu un enseignement scolaire de la Seconde Guerre aux antipodes de ce que j’entendais de la bouche de mon aïeule. J’ai douté une seconde de sa bonne moralité et me l’imaginais déjà exposée sur la place publique, tondue et insultée par une meute hurlante de FFI de la dernière heure. Or, rien de tout cela ! Bien au contraire, ma grand-mère était un modèle de vertu et respectée de tous. Elle finit par me confier avoir plus souffert des bombardements incessants des Alliés au cours des années 44 et 45 que de la présence des Allemands. Ses enfants dormaient tout habillés en cas d’alerte nocturne afin de rejoindre plus vite les abris. Mais pour rien au monde, elle ne les aurait rejoints. Elle voulait voir et tout mémoriser « pour plus tard… » Elle restait là, à écouter le ciel vrombir, exploser et s’embraser. C’est ainsi qu’une nuit, elle assista à un immense feu d’artifice largué par des « Forteresses Volantes », qui s’abattit sur Givet, à dix kilomètres au nord. Bilan : huit morts.
Je terminerai ce récit personnel par la découverte, il y a peu de temps sur la chaîne Arte, d’un documentaire sur les bombardements alliés lors de la Bataille des Ardennes, qui ont rasé des villages entiers et fait périr des milliers d’habitants, considérés comme simples dégâts collatéraux « nécessaires » à la libération, innocentes victimes réduites à l’état de chair à canon.
C’est donc avec un grand intérêt que j’ai parcouru ce livre d’Eddy Florentin. Cet ouvrage dénombre tous ces morts tombés par hasard ou par inadvertance, dans une période où la raison d’État l’emportait sur le droit des populations de vivre ou de survivre sous simplement. Il vient à point pour tout chercheur ou amateur qui désirent trouver une source d’informations fiables sur les pertes en vies humaines, occasionnées par les bombardements alliés entre 1940 et 1945. Page après page, ville après ville, le lecteur n’aura d’autre perspective que de mesurer l’ampleur du massacre, notamment lorsque les déluges de bombes tombaient à côté des cibles par manque d’instruments de navigation précis. Les rescapés de Lorient, de Brest, de Nantes, de Rouen et bien d’autres localités se souviennent encore du martyre de leur ville saccagée, dévastée, exsangue, après le passage des vagues de bombardiers de la RAF et de l’USAF. Bernard Lecournu, sous-préfet de Saint-Nazaire, qui était alerté quelques minutes avant les autres par un système d’alarme non reconnu par l’administration (sa chienne hurlait à la mort lorsqu’elle reniflait la présence de bombardiers), consigna dans un cahier : « J’ai vu mourir de mort violente la ville dont j’étais le sous-préfet. » Les régions du Nord, de l’Est et du Sud ont eu « l’horreur » de partager les mêmes souffrances. Ces raids de plus en plus massifs annonçaient invariablement la mort de centaines d’hommes, de femmes et d’enfants tombés sous le feu continu ou ensevelis sous les décombres des maisons effondrées. Dès que la météo le permettait, il y en avait de la ferraille en l’air : Manchester, Lancaster, Halifax, Stirling, Boston, Liberator, Wellington, Whitley, Spitfire, Hawker Typhoon, Mosquito, etc. En 1943, les Boeing B-17 américains prouvèrent leur capacité à effectuer des tirs diurnes. En conséquence, les Alliés adoptèrent la tactique des bombardements en continu : les Américains le jour, les Britanniques, la nuit. Les pilotes des groupes de chasse français intégrés à la RAF se mêlèrent à la curée tout en prenant soin de ne pas bombarder inutilement.
De l’autre côté de la Manche, les états-majors s’inquiétaient si peu du sort des populations ! Il fallait à n’importe quel prix annihiler l’objectif : usines, gares de triage, ponts, nœuds ferroviaires, ports, arsenaux, entrepôts, etc. S’il n’était pas atteint lors d’un premier raid, ils en remettaient une deuxième couche, voire une troisième. Certes, ces attaques ont pour but de bouter l’armée allemande hors de France en anéantissant sa logistique et surtout, elles préparent l’opération Overlord. Les équipages reçurent toutefois les consignes, en cas de dégâts sur leur appareil, d’éviter les centres habités et d’aller s’abîmer en mer ou dans un fleuve, ou encore, en dernier recours, d’aller s’écraser sur un édifice occupé par les Allemands. Selon Roland Hautefeuille, « la douloureuse question du bombardement des villes normandes doit être examinée sous l’angle suivant : les Alliés pouvaient-ils prendre un risque qui aurait pu entraver les regroupements et embarquements pour Overlord, et reporter une nouvelle tentative au printemps 1945 ? » Au 8 mai 1945, à l’heure du bilan, on dénombre 67 078 civils tués, 1570 localités touchées et 90 000 habitations détruites tandis que les Alliés déplorent la perte de 158 000 membres d’équipage.
Écrit à partir de nombreux témoignages, ce livre est une référence en matière de comptabilité des victimes de part et d’autre de la Manche. Loin d’être une énumération laconique de chiffres monstrueux, il se laisse lire avec plaisir car l’auteur a pris soin de ne pas tomber dans le pathétique ou le misérabilisme. Quelques lecteurs pourront même, sans doute, retrouver dans ces pages les histoires que leur racontait une grand-mère qui ressemblait à la mienne.
Corinne Micelli
648 pages, 11 x 18 cm, couverture souple
NDLR : Cet ouvrage est une réédition. Première parution : 1997.